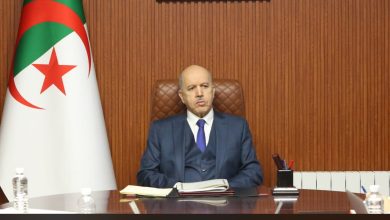Conférence à Alger : l’autogestion, moteur de l’État social en Algérie indépendante

Des experts en économie et des universitaires ont souligné, mercredi à Alger, le rôle de la politique d’autogestion, adoptée par l’Algérie au lendemain de l’indépendance, dans l’édification de l’Etat social, la qualifiant d' »expérience structurante » ayant contribué à jeter les bases d’un modèle propre au pays, fondé sur l’engagement populaire. Intervenant lors d’une conférence scientifique organisée par l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG), en partenariat avec le Centre des archives nationales, les participants ont mis en lumière l’impact de ce mode de gestion des entreprises dans les secteurs agricole et industriel notamment sur la reconstruction économique, sociale et culturelle de l’Algérie indépendante. Selon le président du Conseil scientifique de l’INESG, Djoudi Bouras, « l’autogestion en Algérie ne se résumait pas à un simple modèle économique, elle symbolisait un tournant historique majeur, marquant le passage d’un paradigme révolutionnaire centré sur la libération nationale à un nouveau paradigme de reconstruction ». « L’autogestion a été un instrument fondamental non seulement pour relancer la production, mais aussi pour poser les premières bases de l’Etat algérien solidaire, préfigurant ainsi l’Etat social », a-t-il précisé. Le conférencier a également mis en avant le rôle structurant de l’autogestion dans « la préparation du pays à devenir un Etat émergent, en inscrivant cette politique dans une dynamique de développement économique, social et culturel adaptée aux réalités nationales ». De son côté, l’expert économique Mustapha Bouroubi a estimé que cette politique, qui visait à redémarrer rapidement la production agricole et industrielle au lendemain de l’indépendance, s’était inscrite dans une dynamique nationale reposant sur un « patriotisme économique » et une « mobilisation populaire », citant des exemples concrets d’engagement populaire durant ces années, tels que le Fonds de solidarité nationale ou encore les campagnes de volontariat dans le domaine agricole. Abordant les enjeux contemporains, M. Bouroubi a souligné que la souveraineté économique est actuellement « au cœur des débats mondiaux, qu’il s’agisse de sécurité alimentaire ou énergétique », appelant à « revaloriser le facteur humain comme levier essentiel du développement’. Pour sa part, l’universitaire et ancien ministre de l’Agriculture et du développement rural, Cherif Omari, a rappelé que, dès l’indépendance, la sécurité et la souveraineté alimentaires ont constitué des priorités stratégiques pour l’Algérie. Il a souligné que la campagne agricole de 1962-1963 avait été « sauvée », avec une production de 23,57 millions de quintaux de céréales, « un résultat supérieur à la moyenne enregistrée entre 1955 et 1959 ». L’intervenant a également tenu à rappeler la décision stratégique de création de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) une semaine après la proclamation de l’indépendance nationale, marquant ainsi l’engagement immédiat de l’Etat dans la structuration du secteur agricole.